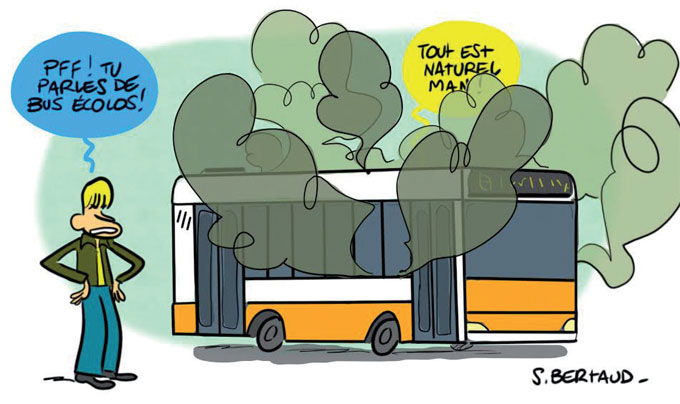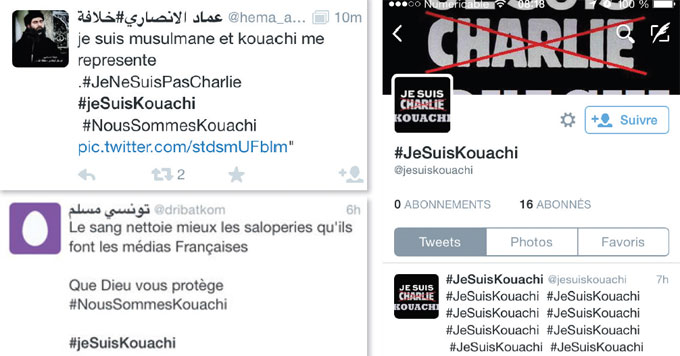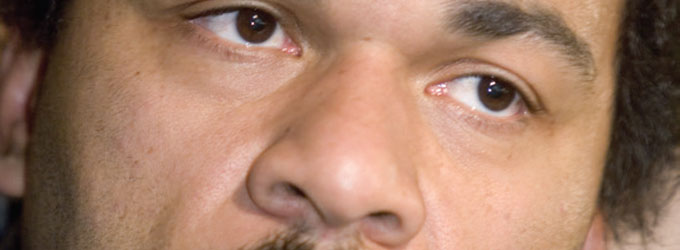Apeurés, trompés sur les réalités qu’on leur a fait miroiter ou dégoutés par ce qu’il se passe sur le terrain et par les conditions de vie difficiles bien cachées par Daech (l’organisation de l’Etat Isla¬mique), des fanatiques déchus font le choix de rentrer. Mais tiraillés entre la peur de se faire tuer par leurs chefs et celle d’être fermement jugés à leur retour, ils se retrouvent dans une situation délicate. En France et en Europe, quelles ont été les situations rencontrées ?
Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur, ils seraient près de 1 100 Français à combattre sur le sol syrien. Des chiffres qui varient et qui restent difficiles à prendre pour acquis tant il est compliqué d’estimer avec précision ceux qui sont arrivés sur le terrain, ceux qui sont en transition ou en partance. La France concentre à elle seule, dans l’Union Européenne, le taux le plus élevé de soldats partis au combat quand la Grande-Bretagne en dénombre 400 et l’Allemagne, 270. Mais ces départs sont aussi, parfois, suivis de retours.
Premières condamnations
En novembre dernier, Flavien Moreau était le premier djihadiste français à passer devant les tribunaux. Condamné à 7 ans de réclusion criminelle, la peine maximale qu’avait requis le procureur à son encontre, il faisait figure d’exemple pour la justice française. Le Nantais d’origine sud-coréenne âgé de 28 ans s’était converti à l’Islam après un passé conflictuel avec la Justice (près de treize condamnations pour délits de droit commun durant son l’adolescence).
Parti en Egypte pour y apprendre l’arabe, c’est là qu’il s’y est radicalisé et a ensuite décidé de partir pour la Syrie. D’après lui, il n’y serait resté qu’une dizaine de jours et n’aurait participé à aucun combat, jouant uniquement un rôle de « surveillance » sur le terrain. Son retour vers la France aurait été précipité par des conditions de vie difficiles sur place, notamment le fait qu’il n’avait ni le droit, ni la possibilité de fumer des cigarettes…
A ses côtés sur les bancs du tribunal, Jonathan-Farid Djebbar, un Français qui avait, lui aussi, glissé vers l’islamisme radical en septembre 2012, changeant même son prénom pour Farid, avait été jugé pour avoir entretenu des correspondances téléphoniques avec Flavien Moreau. Les policiers en charge de l’affaire avaient retrouvé dans son ordinateur plusieurs dizaines de vidéos djihadistes, ainsi que de nombreuses recherches sur la fabrication de bombes artisanales. Jugé pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme », il a été condamné à quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis.
Si ces premières condamnations peuvent servir d’exemple à la Justice française, ces peines rebutent plus d’un djihadiste hésitant mais désireux de rentrer. Ils se retrouvent souvent partagés entre la peur de se faire tuer par leurs chefs, car partir, c’est trahir, mais aussi, être directement emprisonné de retour sur le territoire français.
Selon Farhad Khosrokhavar, sociologue et chercheur à l’EHESS, une « judiciarisation excessive » de ces affaires n’est pas la bonne solution à envisager. Ces personnes endoctrinées, souvent très jeunes, n’ont que peu de chance de se repentir en prison. Le risque serait même plus grand : « Une fois dans la nature, ces personnes, mêmes repenties, sont encore plus dangereuses qu’en entrant en prison. Bien souvent, elles se sont encore radicalisées derrière les barreaux ».
Pas de prison en Suisse
En décembre dernier, c’est un Vaudois âgé de 30 ans qui est passé devant le tribunal suisse. Egalement converti, ce fanatique était parti trois mois en décembre 2013 en Syrie pour rejoindre les camps d’entraînement de Daech. Rentré trois mois plus tard en Suisse, il a affirmé n’y être resté que deux semaines avant de décider lui-même de tout quitter pour repartir, sans avoir participé à un seul combat, selon lui. La Justice suisse a pris une décision inédite et unique, en le condamnant à 600 heures de travaux d’intérêt général avec sursis, accompagné d’un suivi psychiatrique.
L’exemple danois
Dans le nord-est du Danemark à Aarhus, un programme de réinsertion intitulé « Exit » pour les anciens com-battants islamistes de retour après leur séjour en Syrie a été mis en place en 2013. Le pays, qui compterait près de 100 soldats partis au combat, tient à faire figure d’exemple en condamnant la stigmatisation de ces individus, influencés selon eux, par une mosquée de la ville très fréquentée par les salafistes.
Le but de ce programme étant ici, de réinsérer les anciens djihadistes dans la société à travers le dialogue, en leur proposant des solutions et des aides adaptées pour les remettre sur le droit chemin après un sombre passé.
Photo : Des djihadistes de Daech ©DR